Communiqué interassociatif ASPMP-APSEP

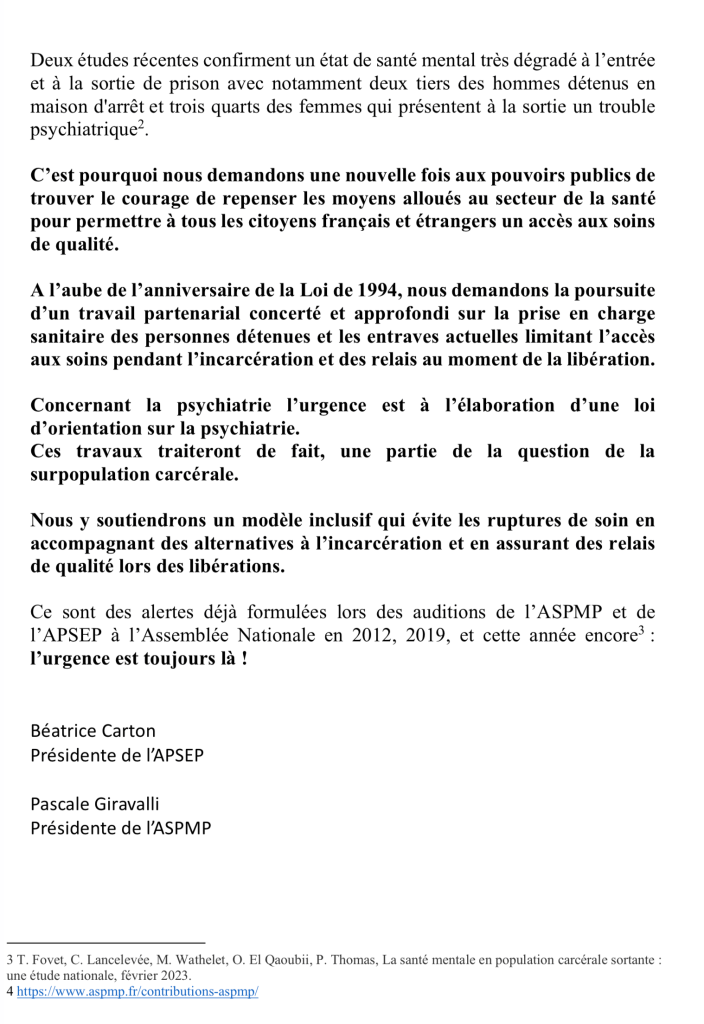
Les personnels d’une Unité sanitaire en milieu pénitentiaire interpellent le directeur de l’ARS PACA, et le Directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, sur l’insuffisance de l’offre et de l’accès aux soins.



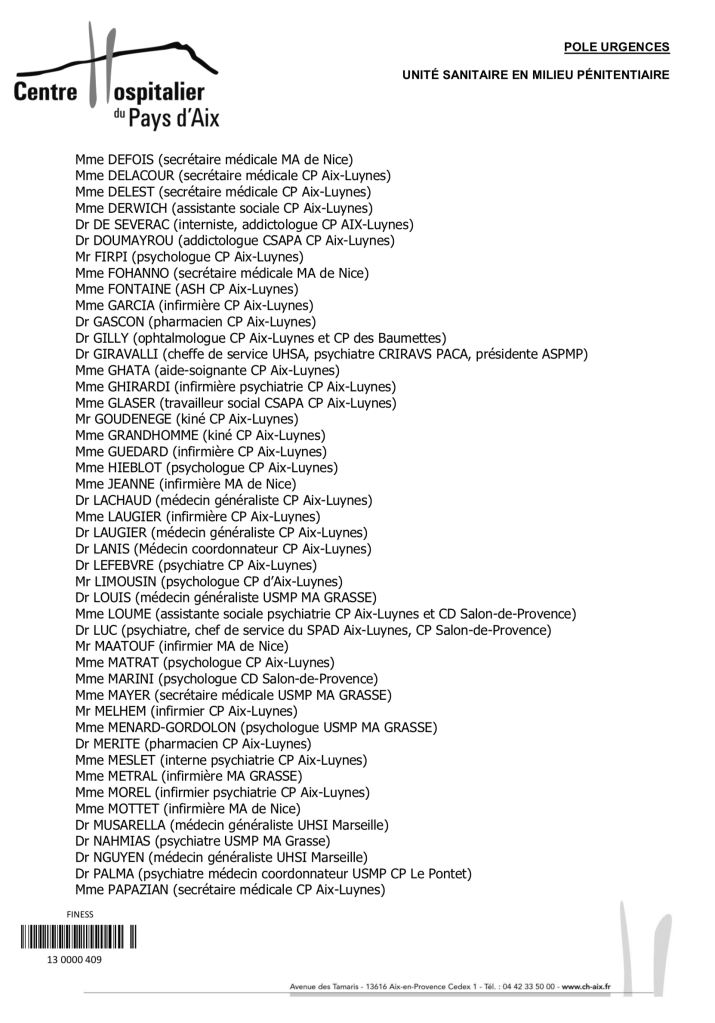


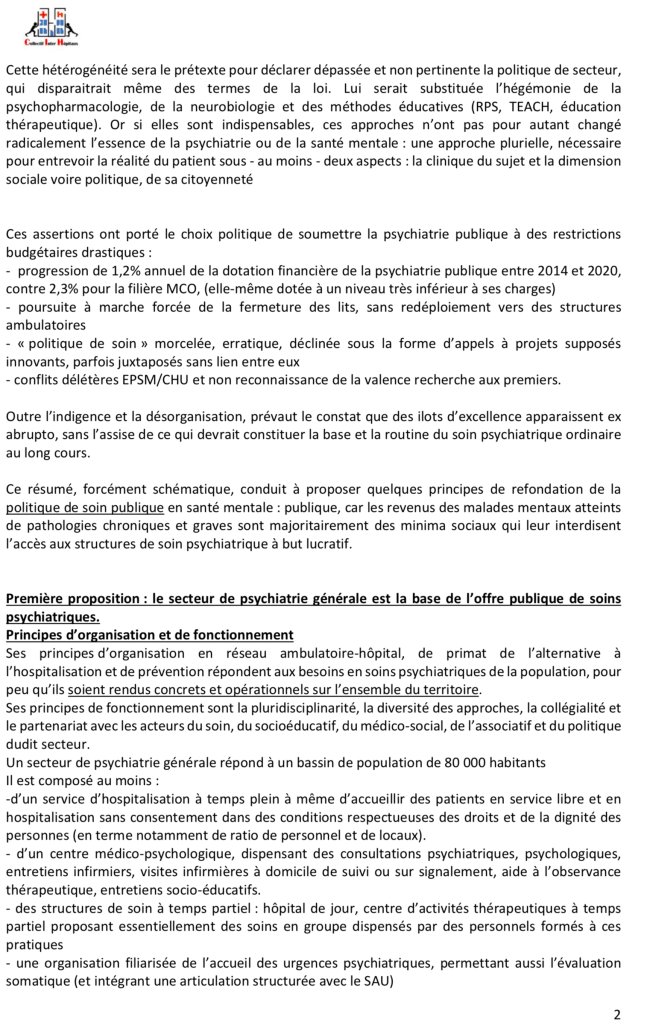
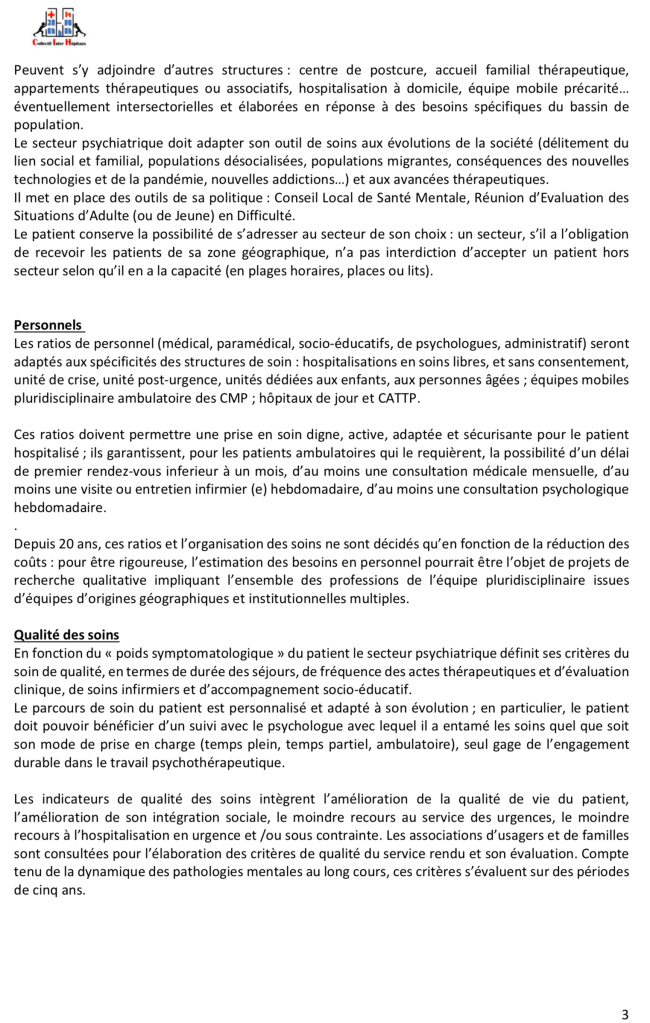


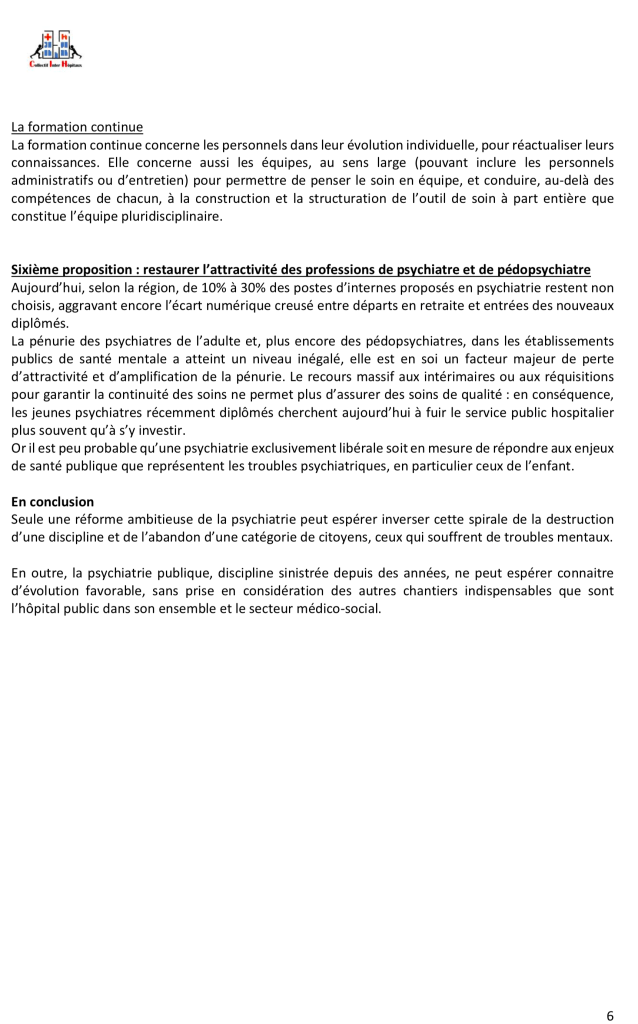
Humble méditation (de pleine conscience) sur le temps des protocoles
Jean-François Rey, philosophe, Pierre Delion, psychiste.
A la manière dont les premiers philosophes de l’Ecole de Francfort, T.W. Adorno et Max Horkheimer, parlaient de notre monde comme d’un « monde administré », on pourrait commencer à observer comment, dans les grandes institutions où se construisait jusqu’à présent le sujet humain (école, université, clinique, bureaux, ateliers), est en train de naître ce qu’on pourrait appeler un «psychisme administré». L’administration du psychisme se donne pour but d’expulser le psychisme du corpus des sciences de l’homme. Par deux procédés confondants de simplicité :
Toute souffrance psychique doit être évaluée à l’aune d’un critère simple : adaptation ou désadaptation.
Toute souffrance psychique peut être traitée à partir du moment où on élimine précisément le psychisme lui-même.
Pour aboutir à un tel résultat, il faut commencer par exclure de la formation des ‘’psys’’ (psychiatres, psychologues cliniciens, psychothérapeutes) toute référence à la réalité psychique. Il faut enfin étayer cette exclusion sur un argument de ‘’scientificité’’ en orientant les recherches, en recrutant des enseignants-chercheurs prêts à cette opération.
Par exemple, la nomination des professeurs d’université se fait désormais en référence exclusive au nombre de points SIGAPS (Système d’Interrogation, de Gestion et d’Analyse des Publications Scientifiques) obtenu par le postulant dans sa spécialité. Mais pour y parvenir, encore faut-il publier en langue anglaise dans des revues à fort « impact factor ». Or ces revues internationales ne publient pratiquement que des résultats de recherches de fort niveau de preuve, c’est-à-dire, des études randomisées. Si ces exigences semblent acceptables en ce qui concerne les enseignements scientifiques tels que les mathématiques, la physique, la chimie, puisque le cœur de leur métier porte précisément sur ce qui est démontrable par les méthodes scientifiques sur lesquelles les chercheurs sont en accord, il n’en va pas de même pour les sciences humaines. Leurs méthodologies de recherches, leurs critères de validité, leurs logiques de démonstration sont sensiblement différentes. Non qu’elles soient moins sérieuses, mais leur objet tourne autour de l’humain, et ce qui vaut pour les objets scientifiques expérimentaux ne peut être exporté sans de grandes précautions pour des sujets humains. Mais l’idéologie scientifique actuelle n’admet pas les précautions à prendre avec les sciences humaines et impose ses diktats sans accepter d’aménagements. Si bien que dans les spécialités médicales telles que la psychiatrie, la pédopsychiatrie, l’addictologie et d’autres, ne sont désormais nommés que les candidats ayant publié des recherches EBM à la suite de travaux en laboratoires essentiellement. Les candidats qui ont misé sur la formation à la psychothérapie, sur la clinique, sur l’histoire de leur spécialité, et sur les aspects anthropologiques de la psychiatrie, n’étant pas publiés dans ces fameuses revues internationales, ne sont plus jamais nommés professeurs dans ces matières. Exit les formations au « psychisme » et à ses avatars. Les gènes et les molécules sont la clé promise pour résoudre ces problèmes neuroscientifiques. De plus, en temps de pandémie, nos décideurs politiques sont passés maîtres dans l’art de nous convaincre du souci qu’ils ont de la santé mentale des français, et à les écouter, ils sont mobilisés pour enfin redonner à ces disciplines toute l’importance qu’elles auraient dû avoir depuis bien longtemps. Sauf que, dans le même mouvement, le service public de psychiatrie continue d’être vendu à la découpe au privé à but lucratif, comme si toutes les maladies graves pouvaient être prises en charge en libéral.
Cela a des conséquences institutionnelles considérables dont souffrent les patients comme les soignants. Les philosophes de l’Ecole de Francfort, et avec eux Walter Benjamin, caractérisaient notre monde (le leur était menacé de l’intérieur par l’irruption des totalitarismes) comme celui du « dépérissement de l’expérience » : comportements massifiés, rapports pédagogiques et professionnels passant de l’éducation, ou de l’apprentissage, au dressage. Au dépérissement de l’expérience correspond la montée en puissance des ‘’protocoles’’. Peu importe la personne que vous avez en face de vous, l’essentiel est de faire entrer vos observations et vos évaluations dans un protocole a priori, le même pour tous. On se croirait revenu à la philosophie morale de Kant telle qu’on l’enseignait, jadis, en terminale : une action morale n’est pas vraiment morale si elle est conduite ‘’conformément au devoir’’. Pour ceux que le mot de ‘’devoir’’ rebute, on lui a substitué la notion (neutre ?) de ‘’norme’’. Un protocole ne dit pas que vous semblez aller mieux, que, si vous hésitez encore à vous mobiliser pour un projet, vous aurez besoin de parler, d’échanger, de rencontrer. Un protocole dit que tout a été fait conformément à une norme que tout le monde est censé partager. S’est-on seulement préoccupé que c’est bien le cas ?
En réalité, il existe deux modalités de philosophies de travail qui devraient rester complémentaires, les méthodes basées sur l’a priori et celles basées sur l’a postériori. La première, celle des protocoles, prévoit ce qu’il convient de faire pour parvenir à tels résultats. C’est le cas des enseignants du primaire qui disposent de modalités pédagogiques pour apprendre à leurs élèves les principaux fondements du « lire écrire compter ». Et pour un élève lambda, cela marche habituellement sans trop de difficultés. Mais tous les instituteurs savent que des élèves ne fonctionnent pas comme les profils gaussiens pourraient le laisser penser. Dans ces cas intéressants, l’instituteur doit se demander a postériori pourquoi cet élève n’a pas suivi les règles pédagogiques classiques. Et le lendemain, une fois l’énigme résolue, il pourra lui proposer une méthodologie spécifique. Que s’est-il passé dans ce temps de résolution de l’énigme ? L’instituteur a réfléchi à l’expérience traversée et en a tiré des enseignements pour modifier sa méthode originelle. Le pathei mathos des Grecs, l’enseignement par l’épreuve, repose sur ce travail a postériori. Dans l’ensemble des sciences humaines, il est facile de comprendre que ce deuxième type de démarche est nécessaire autant sinon plus que le premier. Mais « la science » en a décidé autrement, et les « agents de l’Etat » doivent suivre les protocoles.
Alors qu’elle avait puissamment contribué à la réflexion sur le travail a postériori, notamment avec les avancées de Balint, on fait, dans le même temps, à la psychanalyse un procès en non scientificité. Ce qui n’est pas nouveau, mais se retrouve aujourd’hui au centre de stratégies qui visent, de la santé publique à l’Education nationale, à expulser la réalité psychique et l’hypothèse de l’inconscient. Parvenir à la ‘’pleine conscience’’ serait devenu une opération salutaire, et objet d’une méditation à la mode. En 1890, dans un de ses premiers articles publiés, Freud parlait du « traitement psychique » : « un traitement prenant origine dans l’âme (…) à l’aide de moyens qui agissent d’abord et immédiatement sur l’âme de l’homme. » Un peu plus loin, parlant de ses confrères médecins, il précise : « Ils semblaient craindre d’accorder à la vie de l’âme une certaine autonomie, comme s’ils eussent dû, ce faisant, quitter le terrain de la science. » Ces moyens humains, Freud, en 1890, en connait un qu’il commence à expérimenter, c’est la parole. La parole n’est pas un médium, ou pire, un outil. Elle est un moyen psychique, en tant qu’elle est adressée et incarnée. La parole en psychothérapie ou en analyse n’est ni oraculaire ni instrumentale. Elle présuppose un transfert, dont Lacan a bien montré qu’il n’est une situation intersubjective comme une autre. Toute personne professionnelle en position d’écoute sait que le transfert est essentiel à la poursuite de la cure ou des entretiens. Il n’est pas ce que l’imagerie retient : le vertige et le trouble amoureux de l’un (e) pour l’autre. On peut prescrire des thérapies qui font l’économie de l’inconscient, du psychisme et du transfert. C’est-à-dire des thérapies bâties sur un concept à peu près aussi réel qu’un « couteau sans lame auquel il manque le manche. »
La psychanalyse et ces trois notions (le psychisme, l’inconscient et le transfert) ne sont ni une simple doctrine scientifique, ni une pure instrumentalité. Si on en conteste la scientificité, c’est pour lui opposer un autre modèle qui fonctionnerait sans le psychisme et l’inconscient et passerait outre le transfert, inutile dès lors qu’on brise le cadre même de son apparition.
Mais on aurait tort de croire que, ce faisant, on s’en prend à la seule psychanalyse (freudienne, lacanienne ou autre). Le problème aujourd’hui est autrement plus grave.
Politiquement, il correspond à un projet de normalisation des soins. L’arrêté du 10 mars 2021 fait injonction aux psychologues d’appliquer des thérapies ‘’consensuelles’’, c’est-à-dire des thérapies ‘’recommandée’’ par la Haute Autorité de Santé, autrement dit rien qui relève de la psychanalyse et de la psychothérapie institutionnelle.
Institutionnellement, on annonce la création d’un Ordre des Psychologues. Or il ne s’agit pas d’une institution, au sens où l’instituant ferait irruption pour relancer une dynamique que l’institué aurait mise en sommeil ou en routine. Il s’agit, bien au contraire, d’une extension administrative de l’organisation. On vise à mettre tout le monde à la même toise : le modèle médical généraliste. Si les séances de psychothérapie sont prescrites par un médecin, on en vient à aligner les ‘’psys’’ sur les autres ‘’professionnels de santé’’, comme les kinésithérapeutes ou les orthophonistes. N’accablons pas les médecins généralistes, qui, sauf exception, ne connaissent pas grand-chose à la psychopathologie. Insurgeons-nous plutôt contre l’homogénéisation des pratiques de soin. L’homogène est un élément essentiel de l’administration entropique du psychisme.
Epistémologiquement enfin, le modèle naturaliste qui est mis en avant n’est pratiquement pas (ou pas encore) critiqué pour ce qu’il est. Un contemporain de Freud, le philosophe Husserl, venu des mathématiques, a voulu fonder une discipline philosophique qui résiste aux idées ‘’naturalistes’’ ou ‘’historicistes’ du début du siècle dernier. Les sciences humaines (psychologie, sociologie, histoire) sont alors au début de leur expansion. Parmi les prémisses que Husserl pose en 1911, on trouve ceci : « le domaine psychique est d’abord de l’ordre de ‘’l’expérience vécue’’, de l’expérience vécue aperçue dans la réflexion. » (E. Husserl, La philosophie comme science rigoureuse, traduction française de Marc B.de Launay, 1989, PUF.) Un peu plus loin, Husserl ajoute que le psychisme, dans son articulation avec le corps, offre une « objectivité d’ordre indirectement naturel. » La naturalisation du psychisme repose donc sur une objectivité indirecte qui biaise inévitablement toute Evidence Based Medicine. Que peut en effet l’observation athéorique attachée aux ‘’preuves’’ (evidence) ? Elle transforme tout ce qui vit « en un agglomérat incompréhensible et sans idéal, de faits. » Husserl conclut : « tous partagent la même superstition des faits. »
Or, si les sciences humaines ont à chercher du côté de la rigueur, plus que de l’exactitude, leur mode propre de leur scientificité, l’autorité et le caractère même de ‘’science’’ s’appuie davantage sur les appareils de l’Etat que sur le libre examen. Le Ministère de l’Education Nationale abuse de son autorité en présentant les neurosciences comme LA Science à laquelle les enseignants en formation doivent faire un salut révérencieux avant de passer à la pratique pédagogique.
Autant qu’à un dépérissement de l’expérience, nous sommes confrontés à ce que l’historien du libéralisme, Elie Halévy, appelait l’ « étatisation de la pensée. ». Nous savons bien que si nous suivons cette voie, c’est la pensée qui va dépérir.
Alors, comment résister ? Les philosophes et sociologues qu’étaient Adorno et Horkheimer, ont dû fuir le nazisme pour les Etats Unis. Pour eux, il s’agissait de résister à la persécution, à la domination et à la menace de l’extermination. Ils ont dû penser à la fois le phénomène totalitaire en Europe et l’émergence ou la persistance de préjugés racistes et antisémites chez les américains ‘’ordinaires’’, population sur laquelle ils ont enquêté en vue d’élaborer un type idéal de la « personnalité autoritaire ». Nous, aujourd’hui, dans un contexte différent, nous devons résister dès maintenant avant même que la personnalité autoritaire ne soit à nouveau flattée, encouragée. Mais nous savons comme nos ainés, que nous sommes en présence d’une ‘’organisation’’ dont Walter Benjamin a montré qu’elle était la forme présente du destin (qui a fini par le broyer lui-même). Pour Benjamin, face à l’organisation, il n’y a qu’une résistance possible : celle qui vient de ceux qui sont hors du cercle du pouvoir, du côté du « petit monde médiateur, à la fois inachevé et quotidien, à la fois consolateur et nigaud. » (Cité par Miguel Abensour dans Le choix du petit, postface à T.W. Adorno, Minima moralia. Réflexions sur la vie mutilée. Payot, 2003). Walter Benjamin était l’écrivain du petit, de la moindre des choses, de l’ordinaire, un peu bancal et pas complètement terminé. S’agit-il d’une rêverie d’écrivain, d’une utopie, voire d’une uchronie, sans intérêt pour ceux qui travaillent dans l’Organisation ‘’en grand’’, l’administration du psychisme ?
Un exemple devrait suffire à ne pas se laisser intimider par l’Administration. La clinique de La Borde (fondée en 1953 par Jean Oury), qui existe toujours, au dépit de ceux qui pensent que la psychothérapie institutionnelle est un ‘’rêve du passé, a été, il y a peu, le cadre de ce que l’on pourrait appeler un choix du petit. Un choix pensé et travaillé quotidiennement et qui ne s’invente pas du jour au lendemain. Les repas y sont pris au rez –de-chaussée du ‘’château’’, d’où l’on peut voir la pelouse qui le borde et, en prolongement une forêt. Un bout de cette pelouse, toujours le même, à vingt mètres de l’entrée, était régulièrement occupé par un pensionnaire qui paraissait avoir 17 ans (il devait en avoir 40). Il s’entourait de ses « bribes et morceaux » : vieux paquets de cigarettes, poupées abimées, vieux chiffons. Il les disposait en cercle autour de lui. Un jour il ne vint pas se joindre aux autres patients, soignants et hôtes de passage, alors qu’il y avait ses habitudes. On s’en inquiète, on le presse de venir. Refus : il prétexte que s’il abandonne ses affaires, on va les lui voler. On insiste. En vain. Jusqu’au jour où germe l’idée que si ce garçon ne veut pas venir manger à l’intérieur, on pouvait très bien s’installer avec chaises, tables et repas, sur la pelouse, à proximité du cadre de ce patient. Bien sûr on pense à une révolution copernicienne et, pour notre propos, c’en est une. Mais cette référence est trop massive, trop intimidante. A cette place, aujourd’hui, l’atelier de menuiserie de La Borde a fabriqué et installé une table et des chaises en bois massif, bien fichés dans le sol. Mémorial du petit.
Voilà qui bouscule tous les protocoles que l’on peut imaginer ! Cette action fait droit et place à l’exception, au singulier. Vous imaginez si tout le monde en faisait autant !
par Patrick Coupechoux, mars 2020
L’abandon de la vision humaniste de la folie et du soin, qui s’était développée dans l’après-guerre, a précipité la crise de la psychiatrie. Voici revenu le temps de la contention et de l’isolement, avec, de plus en plus fréquemment, des violations graves des droits des patients. Le personnel des hôpitaux réclame des moyens pour mettre fin à la maltraitance.
Généralement, il y a deux portes qui se font face afin de pouvoir prendre le patient récalcitrant ou violent en sandwich. Le lit est fixé au sol ; parfois il y a un lavabo, parfois non ; parfois il y a des toilettes, parfois non, seulement « un seau hygiénique sans couvercle d’où émane une forte odeur d’urine et d’excréments » ; de toute façon, quand le patient est attaché, il fait souvent sous lui. De temps à autre, on trouve de petits arrangements, comme avec cette jeune patiente présente depuis un an, « sous contention des quatre membres mais dont le lien posé sur l’un des deux bras est ajusté pour qu’elle puisse reposer le bassin au sol sans aide ». Il n’y a généralement pas de bouton d’appel : le patient est obligé de hurler pour se faire entendre, ou, s’il est détaché, de « taper sur la porte jusqu’à se blesser ».
Ses repas, il les prend fréquemment assis par terre, avec son lit en guise de table et en présence de deux soignants, debout face à lui. Il est parfois nu, car on craint, comme on dit, un « risque suicidaire » ; sinon, il est en pyjama jour et nuit. Celui de l’hôpital, car il n’a pas accès à ses effets personnels. Il arrive qu’on oublie depuis combien de temps il est là : « Les soignants, qui sont souvent en poste ici depuis longtemps, disent l’avoir toujours vu. » Les visites lui sont interdites. Dans certains établissements, on teste la vidéosurveillance, les micros et les caméras thermiques dans les chambres d’isolement. Dès lors, rien n’échappe à la vue de l’autre, derrière son écran.
Tout cela n’est nullement une fiction. Ces faits sont extraits de trois rapports de Mme Adeline Hazan, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Elle a établi trois « recommandations en urgence », relatives au centre psychothérapique de l’Ain (Bourg-en-Bresse), en mars 2016 ; au centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne (Loire), en mars 2018 ; et au centre hospitalier du Rouvray, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), en novembre 2019. Ces faits dramatiques — Mme Hazan parle de « violations grave des droits des patients » — montrent que ce sont d’abord les malades qui souffrent de la crise de la psychiatrie. On vient d’évoquer la contention et l’isolement; on pourrait poursuivre avec les fous dans la rue — 30% des sans-domicile-fixe (SDF) présentent des pathologies mentales sévères (1) —, ou encore avec ceux qui croupissent en prison — de 35 à 42% des prisonniers sont considérés comme très malades mentalement (2).
Lire la suite de l’article, publié dans le Monde diplomatique.
APPEL PUBLIC AUX PARLEMENTAIRES
Pour le retrait de l’article 42 indument inscrit dans le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS)
Prévenir les isolements, stopper les contentions
Le 19 juin dernier, le Conseil constitutionnel a obligé le législateur à préciser le cadre des pratiques d’isolement et de contention mécanique des patients en psychiatrie en introduisant l’action du Juge des Libertés et de la Détention (JLD). Parallèlement, la Contrôleuse Générale des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL) a dénoncé les conditions scandaleuses d’utilisation de ces pratiques.
Le mouvement pour le Printemps de la psychiatrie, rassemblant les soignants, les soignés et les familles de soignés – réunis ce jour en Assemblée générale – tient d’abord à affirmer unanimement que ces deux pratiques ne sont pas de nature thérapeutique. Elles ont une finalité sécuritaire. Les rationalisations qui affirment le contraire doivent être déconstruites.
En ce qui concerne la contention mécanique du patient par des sangles sur un lit, il est établi qu’elle accentue la peur, accroît la souffrance, est vécue comme humiliante et au bout du compte constitue un traumatisme pour le patient.
Les pratiques alternatives permettent de l’éviter, comme en atteste la raréfaction de ces contentions vers la fin du siècle dernier. Les institutions psychiatriques ayant développé les dispositifs de « soins sectoriels » ont pu se doter de moyens humains, matériels et immatériels (conceptions de soin) jusqu’à faire disparaitre les sangles des services de soins. Cela parallèlement à la disparition des murs autour de ces hôpitaux. Cette évolution, améliorant la situation des soignés, suscitait la fierté chez les soignants.
En ce qui concerne l’isolement dans une chambre aménagée, cette pratique représente une des alternatives à la contention. Si elle peut constituer un recours en urgence pour contenir l’agitation destructrice ou autodestructrice provoquée par l’état psycho-pathologique de la personne soignée, avant qu’elle ne soit soulagée par des actions cette fois thérapeutiques, c’est l’abus de son usage à d’autres fins qui est inadmissible et doit cesser.
La tendance à abuser de l’isolement et de la contention est croissante depuis deux décennies :
– Le surcroit des isolements résulte d’abord de la raréfaction des moyens humains et matériels dans les dispositifs hospitaliers et extra-hospitaliers, conséquence d’une véritable camisole de constriction financière imposée à la psychiatrie publique. Ôter cette camisole c’est ce à quoi devrait s’atteler le législateur à travers le PLFSS en cours de rédaction.
– Le recul fondamental des conceptions du soin enseignées à l’université et dans les centres de formation, qui sont centrées sur le cerveau (approche biologique, conditionnement) au lieu de la personne (approche bio-psycho-sociale, transférentielle et sectorielle), a une incidence sur la multiplication de ces pratiques. S’y ajoute la perte de toute une culture professionnelle suite à la disparition du diplôme d’Infirmier psychiatrique. Le recul de l’analyse des pratiques et de l’approche institutionnelle des services aggrave la situation.
– Elle concorde également avec des évolutions sociétales ayant entrainé la dégradation des conditions de soin : les conditions existentielles de la population accentuant les besoins de soin psychiatrique, la gouvernance des hôpitaux contournant les médecins et infirmiers, le management déshumanisé et déconnecté de la réalité des soins, l’envahissement du soin par les tâches administratives (codage), le turnover organisé et l’interchangeabilité des soignants et des administratifs, les politiques de santé ruinant l’attractivité de l’hôpital public, etc.
Dans ces conditions dégradées de la psychiatrie française, l’apport du Juge des libertés concernant l’isolement et la contention pourrait apparaître pour certains comme la solution. En effet, l’intervention d’un tiers-protecteur du droit de la personne, est censée stopper des abus. Mais hormis d’exiger le rapport détaillé sur leur mise en œuvre, le juge peut-il condamner les raisons qui entrainent inévitablement leurs usages abusifs ? Non.
Pour le Printemps de la psychiatrie, prévenir les isolements abusifs et stopper les pratiques de contention mécanique passe par un trépied de conditions indissociables :
1/ Des conceptions de soins centrées sur la personne en souffrance psychique, ses besoins et ses droits
2/ Des moyens humains et matériels hospitaliers et extrahospitaliers permettant un accueil rapide de proximité sur l’ensemble du territoire national
3/ L’Action de contre-pouvoir d’un tiers dans les situations litigieuses (JLD, avocat) et dans le contrôle des dérives (CGLPL, psychiatre tiers, associations de psychiatrisés, personnes de confiance, usagers et leurs familles).
Les trois socles de l’édifice de soins intensifs de qualité sont aujourd’hui ébranlés et les abus s’intensifient.
Nous alertons les parlementaires sur le fait que la seule introduction du Juge des libertés et de la détention ne suffit pas. Pour stopper les pratiques de contention et pour prévenir les dérives de l’isolement, il est indispensable de corriger les défauts de la psychiatrie française énumérés plus haut et prendre trois mesures politiques urgentes :
1/ enlever le garrot du financement de la psychiatrie, plus puissamment serré que pour d’autres disciplines médicales,
2/ favoriser l’enseignement des conceptions de soin adaptées et la formation à des pratiques non abusives, parallèlement à l’arrêt des formations à la « gestion de la violence » inadaptées,
3/ favoriser l’action du tiers, parmi d’autres mesures de « soin de l’institution psychiatrique » .
Le Printemps de la psychiatrie adresse aux parlementaires un appel au retrait de l’article 42 sur la contention et l’isolement, indument inscrit dans le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS), et demande que les travaux parlementaires concernant la psychiatrie se fassent dans un cadre législatif approprié et après une vraie concertation.
le 21 novembre 2020, Printemps de la psychiatrie.

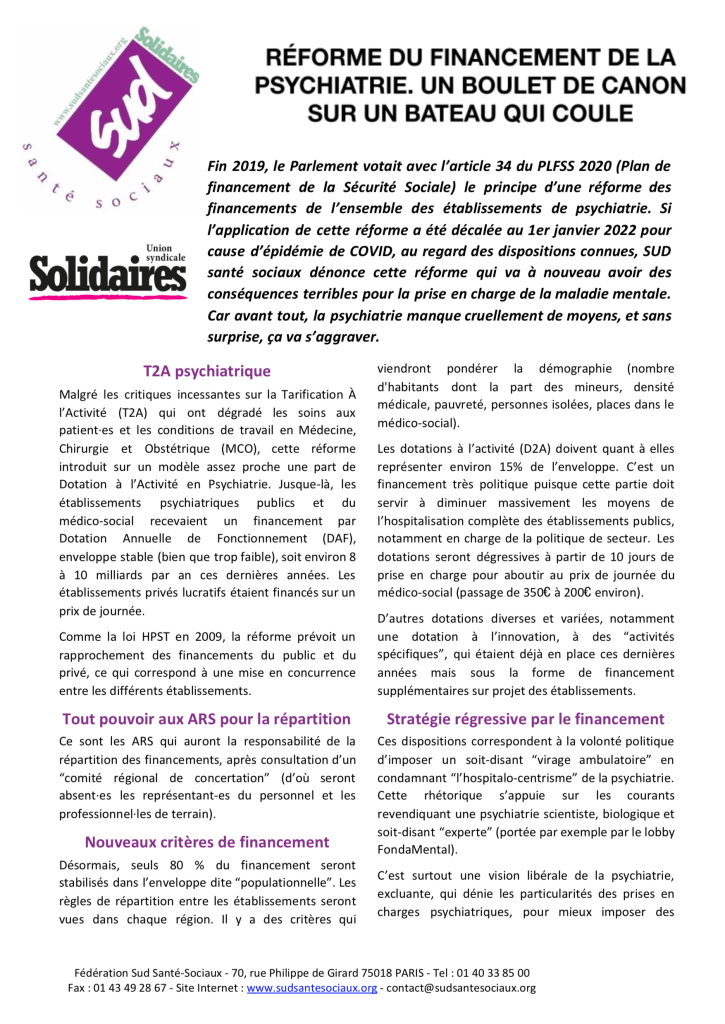

Loriane Bellahsen, psychiatre, décrypte dans ce texte la réforme en cours du financement de la psychiatrie et ses effets dévastateurs sur les soins. Applicable dès janvier 2021, elle est largement dénoncée. Un coup d’arrêt doit y être porté.
(Ce texte a été publié sur le blog https://www.reformepsychiatrie.org où l’on peut trouver d’autres articles critiques de la réforme afin de promouvoir « une psychiatrie vivante et relationnelle »).
La réforme du financement de la psychiatrie, prévue à partir du 1er janvier 2021, dénoncée par de nombreux professionnels1, équipes2, médecins3, dont une soixantaine de chefs de service4, par de nombreuses familles de patients5, par les directions générales de certains hôpitaux, par des parlementaires6, est étonnamment soutenue au sommet de la pyramide hiérarchique par deux présidents des Fédérations des hôpitaux, par les trois psychiatres présidents des Conférences des présidents de CME, par le président de l’association des directeurs d’hôpitaux, par deux présidents de conférences des directeurs généraux d’hôpitaux7.
De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’abandonner le mode de financement actuel, par « dotation annuelle de financement » – dite aussi « enveloppe globale » – qui consiste à allouer une somme d’argent chaque année à la psychiatrie. Ce mode de financement a l’intérêt d’être inconditionnel, pérenne et sécure. En revanche, la hauteur de la somme allouée suscite depuis longtemps d’âpres critiques de la part des professionnels, patients, familles, directeurs d’hôpitaux, parlementaires car cette « enveloppe » est en réalité insuffisante pour soigner efficacement et dignement tous les patients. Il s’agit notamment de ceux qui nécessitent des soins intensifs, pluridisciplinaires, réguliers ou continus, au long cours. Le sous-financement de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie, « grandes oubliées » ou « parentes pauvres » de la médecine, a été décrit à de nombreuses reprises ainsi que ses effets délétères d’abandon d’un très grand nombre d’enfants, adolescents et d’adultes, par défaut de soin8.
Une augmentation de la dotation annuelle de financement est donc, logiquement, attendue par les professionnels et les patients. La réponse du gouvernement n’est pourtant pas celle-là.
La réponse du gouvernement, via l’article 34 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 20209 votée en octobre 2019, alors qu’Olivier Véran n’était pas encore ministre de la santé, mais bel et bien rapporteur de cette loi, est une modification du mode de financement.
Cette modification du mode de financement prévoit, d’une part, de l’insécuriser et, d’autre part, de répartir autrement l’argent sans l’augmenter. On dit de cette réforme qu’elle s’effectue « à enveloppe fermée ». Si certains services, certaines unités, certains pôles gagneront, d’autres perdront, nécessairement10.
Mais comment déterminer ceux qui méritent de gagner et ceux qui méritent de perdre ?
En se basant sur un modèle, celui de la « Santé Mentale »11. Ceux qui correspondront à ce modèle seront favorisés, ceux qui n’y correspondront pas seront défavorisés.
L’instauration de ce modèle se légitime de la « Mission flash » de l’ex-députée LREM et psychiatre Martine Wonner12 et, depuis bien plus longtemps, des propositions de la Fondation « FondaMental » liée à l’institut Montaigne13. Le modèle de la « Santé mentale » rompt avec une approche centrée sur un enfant, un adolescent ou un adulte qui présente les signes d’une souffrance psychique à mettre en perspective avec le développement de son corps ainsi qu’avec son histoire personnelle, familiale et collective.
Elle prône une approche plus économique en prenant en considération que « la mauvaise santé mentale » coûte cher aux entreprises françaises et européennes (à cause des arrêts de travail longue durée, par exemple), qu’il s’agit d’un « fardeau économique » et qu’il s’agit donc de se situer non plus du point de vue de la personne en souffrance mais du point de vue de la société qui doit réduire à son minimum ce fardeau économique pour que le pays demeure compétitif économiquement.
Dans ce modèle, la psychiatre et la pédopsychiatrie ont un autre rôle à tenir. Il ne s’agit plus à proprement parler de « soigner », il s’agit de repérer le plus tôt possible les éléments de la société susceptibles de poser un problème de mauvaise santé mentale, d’apposer sur eux un diagnostic considéré comme définitif, d’évaluer leurs capacités et leurs déficits, de prescrire des médicaments ou des thérapies de choc, de les « orienter » vers des filières de prestataires de service dans le secteur privé où se crée au passage un marché : de rééducation, d’accompagnement, d’aide à la personne, de coaching, etc.
Il s’agit aussi du modèle « de l’Europe du Nord » (Suède notamment) dans lequel on ne finance plus des institutions mais on verse des allocations aux familles pour payer des prestataires de service privés. Bien évidemment, cela coûte moins cher à l’Etat14.
Le problème de ce modèle est qu’il repose entièrement sur une occultation massive, obstinée et parfois violente : l’occultation du fait que certains enfants, adolescents et adultes sont réellement en souffrance et ont réellement besoin d’être soignés et accompagnés au sein d’institutions qui prodiguent des soins pluridisciplinaires, continus ou réguliers, au long cours, et qu’ils ne peuvent aller mieux autrement.
Bien entendu, quand ce type de soin fonctionne, c’est que ces institutions sont accueillantes et chaleureuses, que les professionnels qui y travaillent sont mus par un intérêt sincère envers les patients qui sont considérés comme des interlocuteurs valables (y compris quand ils n’ont pas de langage verbal), que la bientraitance – la vraie, pas celle qu’on affiche en « charte » sur les murs de certains services hospitaliers – fonde le travail.
Ce n’est pas qu’un idéal, ces institutions existent ; et si, vraiment, l’on doit choisir parce qu’il est impossible d’augmenter la somme d’argent attribuée à la psychiatrie dans sa globalité, ne sont-ce pas celles-là qu’il faudrait favoriser financièrement ?
Non, ce n’est pas le choix de nos derniers gouvernements successifs. L’option prise est plutôt de se faire le relais – directement dans les discours de femmes et d’hommes politiques, indirectement à longueur d’émissions de service public – des discours calomnieux sur les institutions pédopsychiatriques et psychiatriques dans leur ensemble, et de prôner un discours d’illusion selon lequel tout enfant, tout adolescent et tout adulte pourrait, dans la période actuelle, trouver sa place harmonieusement à l’école ordinaire et dans le travail ordinaire, à condition que tout le monde soit plus tolérant et qu’il y ait des dispositifs compensatoires. Mais le monde ordinaire et le monde protégé sont-ils obligés d’être présentés comme opposés ? Doit-on vraiment rendre impossible la circulation de l’un à l’autre ? Et puis concrètement, dans la réalité, les moyens sont-ils mis en œuvre réellement dans l’école ordinaire et dans le travail ordinaire pour que ce vœu pieux devienne réalité ? Il est permis d’en douter face aux problématiques majeures que doivent affronter ces deux institutions : le phénomène massif des élèves « décrocheurs » pour l’Education Nationale, la souffrance au travail.
Peu importe ces considérations gênantes, le modèle de la Santé mentale impose une réduction à peau de chagrin des institutions pédopsychiatriques et psychiatriques : il s’agit pour les services adultes, d’hospitaliser le moins longtemps possible avec le moins de moyens possible15 et de favoriser les « centres experts »16 dont l’approche est exclusivement neuroscientifique17 ; pour les services enfants et adolescents, d’encourager une mutation en pôles de diagnostic et d’évaluation des compétences et déficits18. Tout cela justifié par des discours managériaux ad hoc19.
Cette fois-ci, le modèle est introduit par le mode de financement. On nous présente donc un financement « par compartiments ».
L’« enveloppe globale » n’est non seulement plus garantie, mais elle est de surcroît découpée en sept ou huit compartiments, contenant chacun des critères à réévaluer chaque année.
Le compartiment le plus important (actuellement 75 à 80 % du futur financement) est appelé « populationnel ». Il s’agit d’évaluer pour chaque territoire l’intensité de l’« offre » médico-sociale et celle libérale. Par exemple, l’ïle-de-France est considérée comme bien dotée en établissements médico-sociaux et en médecins généralistes, pédopsychiatres et psychiatres libéraux. Pourtant, en tant que psychiatre cheffe de service d’un hôpital de jour pour adolescents et jeunes adultes autistes à Paris, je suis souvent confrontée à l’absence d’établissements, de dispositifs et de praticiens libéraux pour les jeunes adultes ayant atteint la limite d’âge théorique de 24 ans. Par ailleurs, en tant que psychiatre installée en libéral une journée par semaine en Seine-Saint-Denis, je suis confrontée à l’absence pure et simple de pédopsychiatre libéraux dans certaines villes. J’observe également l’absence de certains dispositifs, tels les ULIS-TED (classes spécialisées pour les enfants et adolescents autistes, en école ordinaire).
Si l’Île-de-France est bien dotée, alors dans quel état sont les autres régions ?
D’autres critères sont pris en compte, tel que le nombre de « mineurs » – on ne parle plus d’« enfants », terme trop sentimental ? Ironique quand on connaît l’historique du travail des enfants en France, dans les mines de charbon notamment – et tel que le degré de précarité de la population de cette région. L’idée de fond est que la psychiatrie doit intervenir de la façon la plus courte possible dans la vie d’une personne : « pôles d’excellence », « centres experts », hospitalisations d’urgence… Ont vocation à demeurer des interventions courtes et ponctuelles.
Il s’agit, dès que possible, que la personne soit « orientée ». Elle peut l’être vers le médico-social – secteur également en crise car paupérisé20 – : Foyers de vie, centre d’accueil de jour… Si vraiment elle a besoin d’un établissement spécialisé. Autrement, elle doit l’être vers le libéral : cabinets privés de diagnostic, de formation, d’aide à la personne, ou praticiens libéraux divers, car l’on estime que tout peut s’orchestrer à partir du domicile avec souvent les parents devenus « aidants parentaux » comme chefs d’orchestre.
Le financement du compartiment géo-populationnel sera donc bas pour les régions considérées comme bien dotées en offre médico-sociale et libérale, plus élevé dans les régions considérées comme moins dotées. C’est cet élément dit de justice sociale qui permet à certaines personnes qui promeuvent cette loi de se présenter comme redresseuses de tort voire carrément héroïnes de concepts aussi beaux que l’« inclusion », le « rétablissement » et le « virage ambulatoire » : à les écouter, grâce à cette réforme de financement, les derniers seront les premiers à la Table du Seigneur et la société avancera à grands pas vers un monde où l’usager-consommateur choisira librement ce qui lui convient le mieux. Le problème est, qu’en la matière, le Seigneur n’a pas qu’une Table mais au moins trois : les établissements psychiatriques, les cabinets privés et le secteur médico-social, et qu’il aurait fallu mieux financer et rééquilibrer les trois plutôt que de faire croire que l’on peut passer de l’une à l’autre sans difficulté.
Le deuxième compartiment (environ 15% du financement actuellement) se nomme « DFA », Dotation File Active, ou encore « dotation activité ». La file active est le nombre total de patients reçus au moins une fois dans l’année. Le principe est très simple : plus la file active d’un établissement est élevée, plus le financement augmente. Quel type de pratiques favorise ce principe ? Eh bien les pratiques courtes et ponctuelles. D’ailleurs, dans cette dotation activité, il est prévu que les services intra-hospitaliers perdront de l’argent à partir d’une certaine durée de séjour d’un patient : c’est la « dégressivité des tarifs ».
Uniquement à partir des deux compartiments que je viens de décrire, les simulations financières menées dans différents établissements psychiatriques pour évaluer les effets de la réforme ont abouti à la constatation d’une perte financière tellement massive que certains ont d’ores et déjà dû mettre en place des gels de poste de façon prudentielle.
Examinons pourquoi cette dotation file active est tellement problématique. Prenons un hôpital de jour tel que celui dans lequel je travaille : il accueille actuellement 25 adolescents et jeunes adultes autistes âgés de 14 à 30 ans (notre agrément est de 14 à 24 ans mais l’absence de débouché à 24 ans conduit souvent les jeunes adultes à continuer plus longtemps) qui viennent du lundi au vendredi de 9 à 16H avec un modèle horaire et un calendrier quasiment calqué sur celui de l’école.
Notre file active s’élève donc à… 25 patients par an, auxquels s’ajoutent 5 autres pour lesquels nous effectuons un bilan complet dans notre centre de Diagnostic et d’Evaluation. Cette file active est dérisoire, comparativement à un centre expert de CHU (Centre Hospitalo-Universitaire) qui fait toute l’année du diagnostic en trois séances, ou comparativement à des hôpitaux de jours qui pratiquent des programmes courts de remédiation cognitive en trois semaine.
Les patients que nous accueillons ont d’ailleurs, parfois, déjà bénéficié d’un diagnostic en centre expert, voire d’une remédiation cognitive. Certain ont également effectué tout une scolarisation en ULIS ou classe ordinaire, parfois en parallèle de l’hôpital de jour, d’ailleurs. Ils ont aussi souvent bénéficié d’un suivi génétique à la recherche de cause, et d’un accompagnement par différents professionnels à domicile. Et pourtant, cela n’a pas fait disparaître leur besoin d’un accueil par le collectif de professionnels que nous formons, leur besoin d’un soin et d’un accompagnement pluridisciplinaires, réguliers, au long cours.
Alors, pour nous, hôpital de jour, comment augmenter notre file active ? Quelles sont les solutions concrètes et satisfaisantes que nous avons ?
Eh bien… Il n’y en a pas.
Nous pourrions renforcer notre Centre de Diagnostic et d’Evaluation, qui nous permet, comme indiqué plus haut, d’effectuer un bilan auprès de cinq patients extérieurs à l’hôpital de jour par an. Le problème est que le temps passé à l’analyse des données et à la rédaction des résultats, quand on veut faire les choses sérieusement, n’est alors plus consacré au suivi quotidien des patients de l’hôpital de jour. C’est un choix à effectuer, qui en vaut la peine, à condition de maintenir un bon équilibre entre ces deux pratiques : celle du bilan, et celle du suivi au long cours. Hypertrophier la pratique du bilan viendrait hypotrophier celle du soin des patients qui viennent tous les jours, dont l’intensité, la régularité et la continuité sont pourtant cruciales.
Cette solution trouve donc rapidement sa limite.
Nous pourrions décider tout simplement d’augmenter le nombre de patients que nous recevons, à nombre de professionnels égal. Cela revient à « diminuer le taux d’encadrement », c’est-dire le nombre de patients par professionnels. Actuellement, à titre indicatif, nous avons 5,9 éducateurs (car une éducatrice travaille à 90 %) pour 25 patients.
Mais pour que cela soit possible, il faut que nous accueillions le moins possible de patients qui nécessitent un accompagnement plus intensif. En effet, parmi les personnes autistes, certaines, du fait de leur absence d’autonomie, ou du fait de certains de leurs comportements auto ou hétéro-agressifs, nécessitent que l’on soit en nombre suffisant « un pour un », voire par moment « deux pour un », « trois pour un », pour vraiment bien s’occuper d’elles.
Ces personnes sont celles qui sont déjà les plus exclues du monde ordinaire comme du monde protégé. Or, augmenter notre file active est incompatible avec le fait de favoriser leur accueil dans de bonne condition, avec un personnel en nombre suffisant.
Cette solution n’en est donc pas une.
Nous pourrions décider que dorénavant tous les patients doivent être à mi-temps ou à temps partiel pour pouvoir en recevoir plus. Le problème est que la plupart des patients que nous suivons ont réellement besoin d’un plein temps, et que le « saupoudrage » de prises en charge (une demi-journée par-ci, une séance en libéral par-là) a été dénoncé à juste titre par de nombreuses familles.
Cette solution ne fonctionne donc pas, non plus.
Je viens pourtant de vous énoncer les trois solutions qui sont les plus fréquemment évoquées par les établissements pédopsychiatriques et psychiatriques pour augmenter leur activité.
Autre mauvaise surprise, la réforme du financement de la psychiatrie constitue une double peine pour les hôpitaux de jour accueillant des adolescents et jeunes adultes. En effet, en dehors de cette première peine qui est l’introduction du critère « file active », un autre principe tend à réduire drastiquement notre financement : le strict respect du code civil concernant l’âge des patients et la barrière mineur/majeur à 18 ans.
Pour comprendre cela, il faut d’abord savoir que la psychiatrie adulte est beaucoup moins financée que la pédopsychiatrie (qui est déjà, pourtant, largement paupérisée). Son budget est d’un peu moins de la moitié du budget de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. Jusqu’ici, les hôpitaux de jours accueillant des patients adolescents bénéficiaient du budget de la pédopsychiatrie, même quand le patient dépassait les 18 ans, âge de sa majorité. Cela reconnaissait implicitement que certains enfants, devenus adolescents, devenus jeunes adultes avaient, encore pour un temps, besoin d’une même intensité de suivi et d’un investissement toujours aussi important.
Avec la réforme, il est prévu que cette reconnaissance disparaisse. Dès qu’un patient atteindra ses 18 ans, le financement de l’établissement pédopsychiatrique baissera de plus de la moitié.
Est-ce que cela entraînera des sorties prématurées de patients, à 18 ans, de leur établissement ? Est-ce que cela entraînera le rajeunissement généralisé de l’accueil des patients dans ce type de structure et, en conséquence, un risque de rupture de soin pour les jeunes adultes ? On peut le craindre, en effet.
Mais la « Task Force » qui rédige les décrets d’application de la Loi ne prévoit pas de compensation financière de cette perte et se contente d’annoncer un « capage », c’est-à-dire un lissage des pertes sur quatre ans…
Pour terminer, évoquons maintenant certains aspects importants concernant les compartiments.
Le compartiment « activité » nous fait entrer dans la tarification à l’activité, T2A, dont les effets délétères sont pourtant dénoncés avec force par les professionnels de la médecine, chirurgie, obstétrique21.
Un compartiment « qualité du codage » accentue l’obligation d’entrer des données dans des outils gestionnaires, ce qui pose la question du détournement du professionnel de sa mission de soin en une mission de transmetteur de données et du devenir de ces données22.
Un compartiment « activité spécifique » favorise quelques unités qui ont la cote auprès des financeurs, telles que les UMD (Unités Malades Difficiles).
Un compartiment « recherche » favorise directement les Centre Hospitalo-Universitaires, seuls gagnants de la réforme.
A qui profite le crime ? aux CHU.
Il faut savoir que certains CHU sont en peine, les internes en psychiatrie ne les choisissent plus. Ils n’ont plus de petites mains pour faire tourner leurs services. Une solution a été trouvée : fermer les postes populaires auprès des internes dans les établissements non hospitalo-universitaires (les plus nombreux) et réformer l’internat pour les obliger à choisir des CHU23. Simple comme l’autoritarisme.
J’ai bientôt 40 ans et pas mal d’années de travail devant moi. Je me dis dans les moments sombres que je verrai peut-être la fin des institutions chaleureuses et accueillantes au sein de la psychiatrie publique. Si cela devait réellement être le cas, elles réapparaitraient ailleurs, sous d’autres formes et selon d’autres modèles, parce qu’on certain nombre d’entre nous ont besoin d’y être soignés et/ou ont besoin d’y travailler, pour que la vie ait un sens.
Ce texte est aussi un appel à tous ceux, personnes en soin, familles, professionnels, citoyens, qui veulent penser la suite autrement. En attendant de s’être trouvés, battons-nous pour le maintien des pratiques vivantes que nous avons su déployer ensemble.
Cette réforme scandaleuse doit être purement et simplement abandonnée.
Loriane Bellahsen, le 08/11/2020.
![]() Paris, 14 juillet 2020
Paris, 14 juillet 2020
1 Courrier de Sophie Jacquemont, éducatrice spécialisée, à Emmanuel Macron : https://www.reformepsychiatrie.org/?p=131 Courrier d’une enseignante spécialisée à Emmanuel Macron : https://www.reformepsychiatrie.org/?p=129
2 Vidéo du Centre Françoise Grémy : https://www.reformepsychiatrie.org/?p=98
3 Communiqué du Collectif Inter Hopitaux du 24 Octobre 2020 : https://www.reformepsychiatrie.org/?p=780
Les troubles du compartiment du gouvernement: après la T2A, voici la T2C-psy, Mathieu Bellahsen, 13/09/2020, Mediapart, https://www.reformepsychiatrie.org/?p=691
Non à la T2A en psychiatrie Communiqué commun du l’Union Syndicale de la Psychiatrie, de la CGT, de SUD et du collectif Printemps de la psychiatrie, 25/05/2020 : https://www.reformepsychiatrie.org/?p=323
Courrier de Loriane Bellahsen, psychiatre, chef de service, à Emmanuel Macron : https://www.reformepsychiatrie.org/?p=37
4 Compartimenter n’est pas soigner Tribune parue dans « le Monde » le 8 Octobre 2020 : https://www.reformepsychiatrie.org/?p=767
5 Cri d’alarme sur l’abandon annoncé de milliers de prises en charge d’adolescents et jeunes adultes autistes Courrier à olivier Véran du 26/10/2020 : https://www.reformepsychiatrie.org/?p=783 Courrier de Mme B, mère d’une jeune fille autiste, à Emmanuel Macron : https://www.reformepsychiatrie.org/?p=42 Courrier Mme P, mère d’un jeune homme autiste, à Emmanuel Macron : https://www.reformepsychiatrie.org/?p=125 Courrier Mme L, mère d’un jeune homme autiste, à Brigitte Macron : https://www.reformepsychiatrie.org/?p=127 Courrier Mme V, mère d’un jeune homme autiste, à Emmanuel Macron : https://www.reformepsychiatrie.org/?p=123 Courrier de Mme C, mère d’une jeune femme autiste, à Emmanuel Macron : https://www.reformepsychiatrie.org/?p=45
6 Question écrite de Stéphane Peu, député de Seine-Saint-Denis, à M. Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé, le 12 Mars 2020 : https://www.reformepsychiatrie.org/?p=70
Psychiatrie, menace sur la qualité des soins, Question de Clémentine Autain, députée de Seine-Saint-Denis, à Olivier Véran, le 29 Juin 2020 : https://www.reformepsychiatrie.org/?p=624
7 Courrier commun aux conférences de PCME et de directeurs, à l’ADESM, à la FEHAP et à la FHF du 03 Novembre 2020 : https://www.fehap.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/20-courrier_commun_-_financement_de_la_psychiatrie_2020_v3.pdf
8 Débat CRCE : Situation de la pédopsychiatrie en France, Intervention de Mme Laurence Cohen, Sénatrice du Val-de-Marne, Vice-Présidente de la Commission Affaires SocialesMembre du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et Ecologiste : https://www.reformepsychiatrie.org/?p=68
9 Article 34 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2020, portant réforme du financement de la psychiatrie : https://www.reformepsychiatrie.org/?p=372
10 La réforme du financement est désormais imminente mais garde des zones d’ombre, Hospimédia, Caroline Cordier, le 19/10/2020 : https://abonnes.hospimedia.fr/dossiers/20201017-psychiatrie-la-reforme-du-financement-est-desormais-imminente.pdf
11 Mathieu Bellahsen, La santé mentale. Vers un bonheur sous contrôle, Paris, La Fabrique, 2014, 186 p., Préface de Jean Oury
12 Mission flash sur le financement de la psychiatrie – mercredi 6 février 2019 :http://www.adesm.fr/wp-content/uploads/2019/02/Communication-mission-flash-financement-de-la-psychiatrie-finale-modifiée.pdf
13 « Fondamental », la fondation qui veut sauver la psychiatrie en partenariat avec les labos Rachel Knaebel, 15 Octobre 2018 : https://www.bastamag.net/Fondamental-la-fondation-qui-veut-sauver-la-psychiatrie-en-partenariat-avec-les
14 Pour aller plus loin sur ces questions, lire La révolte de la psychiatrie, les ripostes à la catastrophe gestionnaire, Rachel Knaebel et Mathieu Bellahsen, avec la collaboration de Loriane Bellahsen, éd. La Découverte, 2020
15 16 mai 2020 – Une astreinte, du flux, un soldat dans une basse-cour. Geneviève Hénault : https://www.reformepsychiatrie.org/?p=560
16 L’expertise contre l’expérience, Loriane et Mathieu Bellahsen, Savoir/Agir, N°52, 2 septembre 2020 : http://www.savoir-agir.org/Parution-du-numero-52-de-Savoir.html
17 Le cerveau, le cerveau, vous dis-je ! Laurine Ringenbach, 31 Mai 2020 : https://www.reformepsychiatrie.org/?p=380
18 Arrêtez de Restreindre le Soin ! Par le Dr BB : https://www.reformepsychiatrie.org/?p=630
Non à un désastre sanitaire de plus ! Nouveau cahier des charges des CMPP imposé par l’ARS de la Nouvelle Aquitaine , Communiqué officiel de la Fédération Française de Pédopsychiatrie (FFP) du 19 Mai 2020 : https://www.reformepsychiatrie.org/?p=331
19 Traquer le management par Moïra : https://www.reformepsychiatrie.org
20 Mesures d’accompagnement du secteur médico-social privé non lucratif, question écrite de Stéphane Peu à Olivier Véran, 4 Novembre 2020 : https://www.reformepsychiatrie.org/?p=789
21 Conférence de presse du CIH, Collectif Inter-Hôpitaux, du 5 Mai 2020, qui décrit les effets de l’épidémie liée au coronavirus sur les services hospitaliers : https://www.youtube.com/channel/UC3EubJ7eBbLxP_nHV6ZWZvg
22 Communiqué du Collectif de la pédopsychiatrie du 19ème en lutte : « Nous sommes en grève des données informatiques », 27 Mai 2020 : https://www.reformepsychiatrie.org/?p=327
23 Réforme de l’internat: internes en colère : https://www.reformepsychiatrie.org/?p=591

Tribune du Fil Conducteur Psy *, lien pour signer la pétition.
ABOLITION DE LA CONTENTION …
… ET DE L’ISOLEMENT
Le 19 juin 2020 le Conseil Constitutionnel rendait sa décision à la suite d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QCP) portée par le Cercle de Réflexion et de Proposition d’Actions sur la Psychiatrie (CRPA). Cette décision devrait aboutir à une modification de la Loi du 26 janvier 2016. « L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée», précise l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, issu de cette loi de 2016.
Le Conseil Constitutionnel considérant que cet article ne mentionnait aucune limite de durée ni de contrôle judiciaire, l’a déclaré contraire à la Constitution ; l’idée étant de faire encadrer ces pratiques par un Juge des Libertés et de la Détention (JLD) dans un délai court ce qui permettrait de sauvegarder le principe de liberté individuelle.
Or, depuis la Loi de 2016 qui visait déjà à encadrer les pratiques de contention, puis les préconisations de la Haute Autorité de Santé (H.A.S) s’évertuant à fournir des normes de « bonnes pratiques », les dérives en matière d’hospitalisation sous contrainte n’ont cessé d’être signalées et dénoncées durant le mandat de la Contrôleure Générale des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL) Adeline Hazan : personnes sanglées depuis des mois, chambres insalubres voire délabrées, aucun bouton d’appel pour les patients,…
Non seulement ces pratiques indignes augmentent mais elles se généralisent car les accueils se font en urgence, sous les contraintes de plus en plus fortes de manque en personnels soignants, en lits disponibles … en structures d’accompagnement en amont et en aval de l’hospitalisation, détruites au fil des 30 dernières années, pour prévenir et accueillir les patients et éviter les rechutes.
Les rares enquêtes – dont 2 enquêtes australiennes – ayant accordé la parole aux patients mettent en lumière le traumatisme de la violence de telles pratiques qui avivent et accroissent leur souffrance. Quant aux soignants, ils sont maintenus dans un dilemme éthique parfois insoutenable dont ils témoignent : « On demande juste à pouvoir travailler dans la bientraitance et la bienveillance, c’est tout. On est là pour les patients, on n’est pas là pour nous », dixit les soignants de l’Hôpital Psychiatrique du Havre, appelés « les perchés du Havre » en 2018.
Face à cette tension dans l’éthique du métier, les « rationalisations » de l’effet soignant de l’intervention mécanique sur le corps du patient persistent aussi au sein de la profession dont les formations universitaires se sont appauvries au profit de conceptions sécuritaires et gestionnaires visant à juguler la peur du patient qui fait peur.
L’isolement et la contention, qui vont fréquemment de pair – puisqu’en isolement, les patients sont contentionnés au motif de leur éviter d’attenter à leurs jours – ne peuvent être considérés comme des actes thérapeutiques : ce ne sont pas des soins.
Ces pratiques signent :
un échec de l’accueil des patients en souffrance psychique intense,
un échec de l’organisation des soins et de la disponibilité des moyens dans les hôpitaux,
un échec de la formation professionnelle puisque les soignants en psychiatrie n’ont plus de formation spécifique pour travailler leurs peurs et leurs postures face aux peurs et aux réactions des patients.
Ces pratiques produisent l’enfermement des patients et des soignants dans un cercle de violences institutionnelles. C’est pourquoi il devient urgent d’œuvrer aux côtés des collectifs, des associations, des syndicats de la santé soucieux d’une approche plurielle et humaniste des soins en psychiatrie pour :
Abolir les mesures de contention et d’isolement,
Refonder une conception et une organisation de l’hôpital psychiatrique comme lieu de soin plutôt que d’enfermement,
Former des psychiatres et des infirmiers dans le souci d’une psychiatrie restauratrice des liens d’humanité pour les patients.
Nous appelons à une large mobilisation les organisations soucieuses de la défense des droits de l’Homme dont sont exclus de fait les patients lorsqu’ils subissent la violence de telles pratiques déjà dénoncées au niveau de l’Europe.

* Le Fil Conducteur Psy est une association qui rassemble des familles, des parents et fratries, des patients et des soignants pour défendre une conception humaniste de la folie.