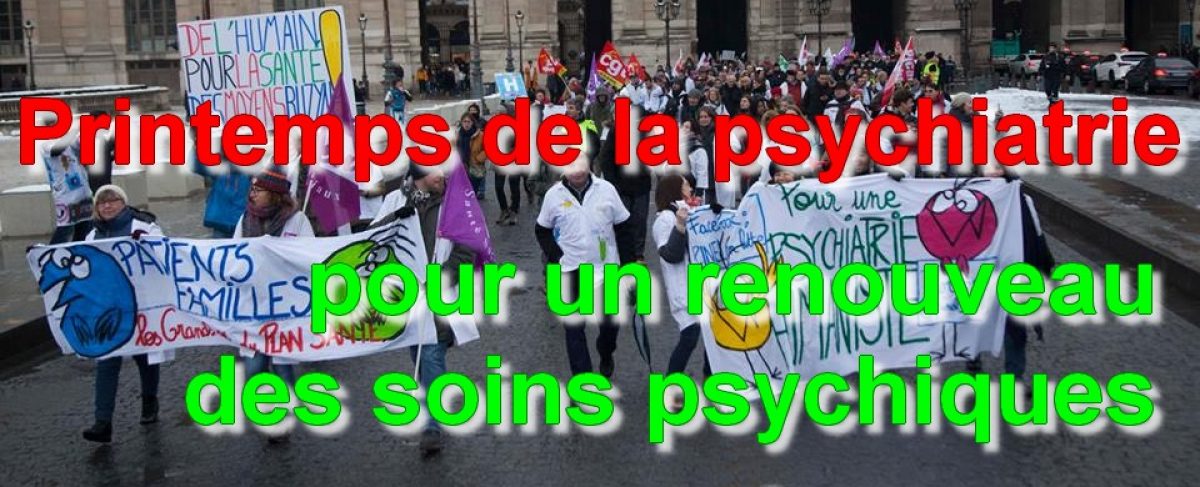Dominique Terres Graille (Appel des appels) et Catherine Skiredj Hahn (Le Fil conducteur Psy)
Lire sur ce blog d’autres articles du Fil conducteur Psy , signataire du Manifeste pour un renouveau des soins psychique du Printemps de la psychiatrie.

Intervention de Dominique Terres Graille :

pour lire la suite l’intervention de Dominique Terres Graille ouvrir ou télécharger le PDF :
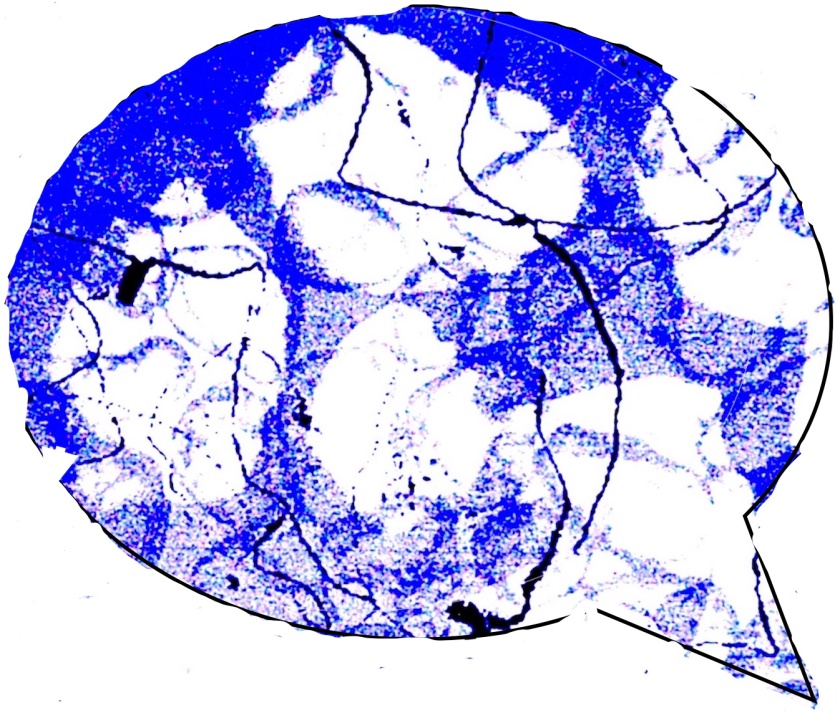
Catherine Skiredj Hahn, le Fil Conducteur Psy
Quelle inscription dans cette histoire que vient de situer Dominique Terres Graille ?
Ou l’effet Assises pour nous à la suite de celles de 2013 : « Quelle hospitalité pour la folie ? »
Les Assises allaient asseoir une parole plurielle d’acteurs, familles, patients, soignants qui depuis partagent leurs points de vue sur la conception du soin psychique.
En effet, parmi les ateliers organisés, l’un dénommé « atelier familles » avait rassemblé une centaine de participants, dont nous étions : parents, fratries, famille au sens large, proches, patients et soignants. Rassemblés pour témoigner de l’expérience de la rencontre avec la dissociation ce qui n’est pas rien.
Ce moment qui fit lien pour dire le désespoir, la souffrance qui bouleverse les psychés, l’incompréhension des parcours de soins chaotiques ; en somme un moment d’hospitalité de nos paroles face à nos détresses vécues bien souvent dans une solitude et un isolement ressenti comme une blessure qui désigne celles et ceux d’entre nous profondément affectés par cette expérience. Mais aussi une expérience de vie qui humanise autant qu’elle met au risque de la désintégration, de la déstructuration.
La fluidité de la parole et l’émotion éprouvée ensemble lors de cet atelier furent telles que nous avons eu l’élan de prolonger ce moment intense d’échanges.
Car il fallait bien tenter de mettre de la cohérence dans des parcours de soins hachés, segmentés, fragmentés alors même que la maladie psychique apparaît elle-même comme perte de la cohérence interne du sujet …
Lutter contre la déraison des parcours psychiatriques, réfléchir et comprendre ce que nous fait la déliaison tant du côté du soin atomisé, robotisé par les réponses médicalisées et protocolisées dominantes, que celle que nous vivons du côté de nos proches touchés par la maladie.
Il y avait du Fil à retordre, des mises en interrogation à tisser pour nous soigner aussi, pour contenir nos désespérances, les partager pour les mettre à distance par l’élaboration réflexive. En quelque sorte, penser ces expériences pour panser nos maux par une mise en mots.
C’est l’histoire récente du Fil conducteur psy. Il s’agit de faire entendre une voix singulière, des sensibilités qui ne soient pas lissées, écrasées par des considérations tactiques de représentation politicienne.
L’humanisation, selon nous, c’est apprendre à se parler, accueillir et considérer nos places différenciées en tant que familles, ou proches ou patients ou soignants, nos rôles différents et nos points de vue pour les mettre en débat, en dégager des pistes de proposition d’actions.
Il nous fallait parler de ces mises systématiques ou presque en pyjama, de ces périodes d’isolement durant lesquelles de plus en plus souvent des contentions sont pratiquées quand elles ne le sont pas dès l’arrivée aux urgences.
Il nous fallait parler de l’état dans lequel se trouvent plongés les patients : une médication qui les fait trembler, qui révulse et fige leur regard, qui transforme leur corps, rend leur diction difficile : une lente descente … avec ce sentiment d’impuissance à apaiser la souffrance qui enserre les patients, leurs proches, leur famille.
Il nous fallait parler du désert des formes de soutien et d’accompagnement avant et après l’hospitalisation. De ces déambulations de corps inoccupés dans des couloirs sans fin.
Il nous fallait partager cela : comment tenir face aux injonctions muettes qui nous minent à bas bruit surtout depuis le trop fameux « virage ambulatoire ». Redécouvrir les proches, la famille à la sortie d’hospitalisations de plus en plus courtes, sans soutien et perspectives au sortir, et l’ignorer quand elle demande de l’aide en période de crise, refuser d’entendre la détresse parentale lorsqu’un patient adulte est soi-disant censé être capable de faire la démarche pour se faire hospitaliser, qu’il lui revient de passer un « contrat » pour être hospitalisé en pleine situation de crise. C’est sans doute ce que signifient les formules valises du type « le patient au cœur de son parcours de soin » ou encore « être acteur de son projet de vie ». Le silence abyssal de l’équipe hospitalière (on est loin de l’hospitalité là) quand la souffrance psychique enserre et isole dans l’intime du drame familial tout en faisant glisser le soin et la responsabilité du côté de la famille au sortir de l’hospitalisation…
La famille, longtemps rendue responsable de la maladie de son proche, est souvent devenue solution comme recours alternatif à la prise en charge dans le système de soins, au motif avancé comme vertueux d’une meilleure inclusion de nature à favoriser la dé-stigmatisation et la dé-culpabilisation des familles à qui l’on dit aussi : « c’est une maladie comme les autres » pour soi disant les rassurer.
Il nous fallait partager nos colères, nos incompréhensions face à des situations qui mobilisent une telle énergie pour ne pas sombrer dans l’épuisement, le risque d’effondrement.
Comme une nécessité pour tenir, se soutenir sans s’anéantir …
Comment trouver des appuis pour mesurer les dégâts de cette période, ce moment d’histoire que nous traversons où le sujet est rabattu sur ses fonctions organiques, désubjectivisé, réduit à ses seuls dysfonctionnements cérébraux. Une histoire de dopamine … une histoire de récits sur des cerveaux déréglés qui voudrait nous décerveler en tentant de nous faire croire à cette chimère d’un sujet vide, exproprié de l’épaisseur de son histoire, réduit à ses pulsions folles et dangereuses. Tout comme les soignants, expropriés de leurs gestes professionnels, de leur savoir expérientiel de métier … par la protocolisation et le comptage effréné de la traçabilité des actes.
Comment regarder sans broncher la mise en place de ces plate-forme « centres de tri » pour catégoriser et classer les patients selon leur pathologie, telles des gares de triage qui aboutissent à des voies de garage assorties de bricolages ?
Où est le soin ? Où se situe la clinique du soin ? La clinique qui prend soin du soin psychique ?
Ces 2 journées y sont consacrées dont les 6 ateliers, pensés dans un esprit de libre disposition pour organiser leurs échanges ainsi qu’ils l’entendent.
Et pour ne pas reprendre cette belle phrase de René Char :
« Nous ne sommes pas ensemble le produit d’une capitulation ni le motif d’une servitude plus déprimante encore » René Char, lettera amorosa
C’est bien dans cet esprit que s’ouvrent les Assises citoyennes du soin psychique.
Belles journées, beau travail.
Merci pour votre présence.
Lire sur ce blog d’autres articles du Fil conducteur Psy , signataire du Manifeste pour un renouveau des soins psychique du Printemps de la psychiatrie.